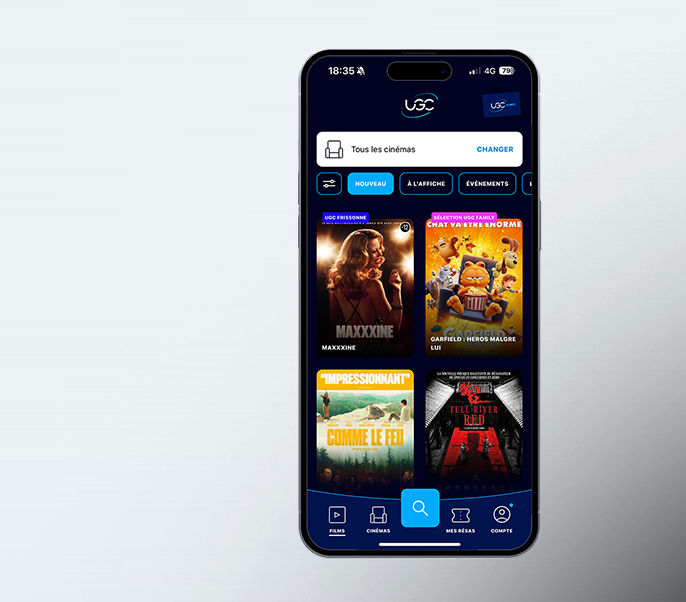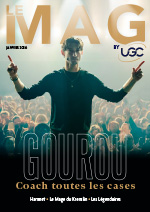LA VENUE DE L'AVENIR
Réunis chez le notaire, les descendants de la famille Vermillard-Meunier apprennent qu’ils sont les héritiers d’une belle demeure en Normandie ayant appartenu à leur ancêtre Adèle. En fouillant la maison, les cousins éloignés apprennent que cette dernière a quitté la région du Havre en 1895 pour retrouver sa mère installée à Paris. Mais aussi que leur aïeule a vécu une vie que l’on pourrait qualifier d’impressionniste.
Pourquoi y aller :
Derrière cette fable, à cheval sur deux époques et racontée en mode choral, comme souvent avec le réalisateur de L’Auberge espagnole, se cache l’un des longs-métrages les plus enthousiasmants de Cédric Klapisch (Le Péril jeune, Chacun cherche son chat…). Il donne un coup de frais au film à costumes, explore le Paris de la Belle Époque, à la fin du XIXe siècle, avec le regard curieux de l’éternel étudiant. Et défend même une morale tout à fait sensée : au passé comme au présent, le regard artistique sur la vie est une histoire d’amour.
ENTRETIEN AVEC CÉDRIC KLAPISCH
La Venue de l’avenir est votre quinzième long-métrage, et, pour la première fois de votre carrière, il se retrouve sélectionné au Festival de Cannes. Comment avez-vous pris cette nouvelle ?
J’y vais avec du recul, mais je me nourris du bonheur des autres, puisque les membres de l’équipe du film sont en joie à l’idée de se retrouver à Cannes. Quand j’ai annoncé la sélection dans notre groupe Whatsapp – « Les acteurs d’avenir » – ça a provoqué plein d’enthousiasme. Bref, tu réalises que Cannes change encore la vie d’un film, d’une équipe. Pour ma part, je ressens comme un mélange de deux choses : forcément, je suis super heureux, mais aussi abasourdi. Dans ma vie, j’ai dû me rendre à ce festival au moins une trentaine de fois et ça m’a permis de saisir la dynamique d’un festival de cette dimension tout en déconstruisant son côté éphémère, voire « miroir
aux alouettes »… Il y a les longs-métrages dont la projection provoque plein de réactions définitives et de pronostics de Palme d’Or, mais qui, malgré ça, vont repartir bredouilles et ne marcheront pas. Le contraire existe aussi. Est-ce qu’il y a du rationnel là-dedans ? Pas tant que ça, et c’est très bien ainsi…
En plus de raconter deux époques – celle contemporaine et celle de la France de 1895 –, votre film aborde la place de l’image et de sa signification. Il parle des peintures impressionnistes, des débuts de la photographie, mais aussi des portraits que certains influenceurs vont utiliser pour illustrer leurs réseaux sociaux… Est-ce qu’on comprend mieux une époque en s’interrogeant sur son rapport à l’image ?
On devrait interroger les images sans arrêt – celles du passé comme celles d’aujourd’hui. À partir de quel moment l’industrie les dénature ? Par exemple, je ne suis pas contre la mode, mais quand je vois certaines photos que l’industrie de la fashion ou de la fast-fashion nous impose, ma première réaction c’est de trouver ça ridicule. Pareil avec les images que l’on trouve sur les réseaux sociaux. Comme je fais de la photo, j’ai adoré les débuts d’Instagram. Le côté carte postale – avec plein de filtres et une légende – me plaisait énormément. Je trouvais ça innocent et donc artistique. Maintenant que ce réseau social est aussi devenu un outil de marketing et d’autopromotion, je l’utilise moins… Le début du film parle de ce ressenti. On voit un jeune couple dans un musée pour une pub. Lui aimerait devenir créatif et filme sa copine devant un tableau. Comme elle ne sait pas s’il l’a bien cadrée, elle lui demande : « Mais est-ce qu’il y a assez de moi ? » Cette première phrase résume mon malaise face à certaines images aujourd’hui. « Est-ce qu’il y a assez de moi ? » est presque une problématique de notre époque.
Les tableaux impressionnistes tiennent aussi une grande de place dans La Venue de l’avenir. Quel est votre rapport à la peinture ?
Je n’étais pas un grand passionné de peinture avant ce film. Mais en lisant beaucoup et en me renseignant sur ce mouvement pour préparer le film, mon regard a changé. Je savais que j’aimais les tableaux de Monet, mais je ne savais pas jusqu’à quel point ils pouvaient me toucher. Aujourd’hui, le rapport entre ce mouvement pictural et la nouvelle vague cinématographique me semble évident. Dans les deux cas, il y a une notion de spontanéité et d’opposition aux anciens. Mais aussi les nouvelles technologies de leur époque qui ont permis de sortir de l’atelier comme du studio de tournage. C’est fou le nombre de correspondances qu’il y a entre la peinture impressionniste et le cinéma de la nouvelle vague.
Il est rare, dans vos films, qu’il y ait des conflits entre les générations – un motif qui traverse pourtant de plus en plus la société actuelle. Vous sentez-vous en décalage sur ce sujet ?
La fracture générationnelle, ça n’existe pas tant que ça. On a beaucoup à gagner à prendre au sérieux la jeunesse et sa culture. En mai 1968, les étudiants avaient raison de remettre en cause le pouvoir et leurs aînés. Aujourd’hui Greta Thunberg et les activistes écologistes, féministes ou LGBT mènent de justes combats. Pourquoi ne pas faire cause commune ou au moins chercher à se comprendre ? On a tous envie que le monde soit moins discriminant, moins violent, moins angoissant… Je me souviens qu’a l’époque où j’ai participé à la création du site La Cinetek, on avait demandé à des cinéphiles de 20 ans de nous dresser une liste des films qui parlaient à leur génération. Quelques critiques s’étaient bien foutus de moi : « Vous allez tomber de haut avec votre Cinetek, les gars. Jamais des jeunes ne s’abonneront pour voir À bout de souffle ! » Totalement faux ! La majorité des films que privilégient les gens de 25 ans sur la Cinetek viennent du passé. En ce moment Ozu est l’un des auteurs que semble privilégier la nouvelle génération. On est quand même loin des clichés sur la jeunesse qui ne vivrait que dans le présent, non ?
Cet article est issu du Mag by UGC.
La Venue de l'avenir, un film labellisé UGC Aime, à découvrir actuellement au cinéma.